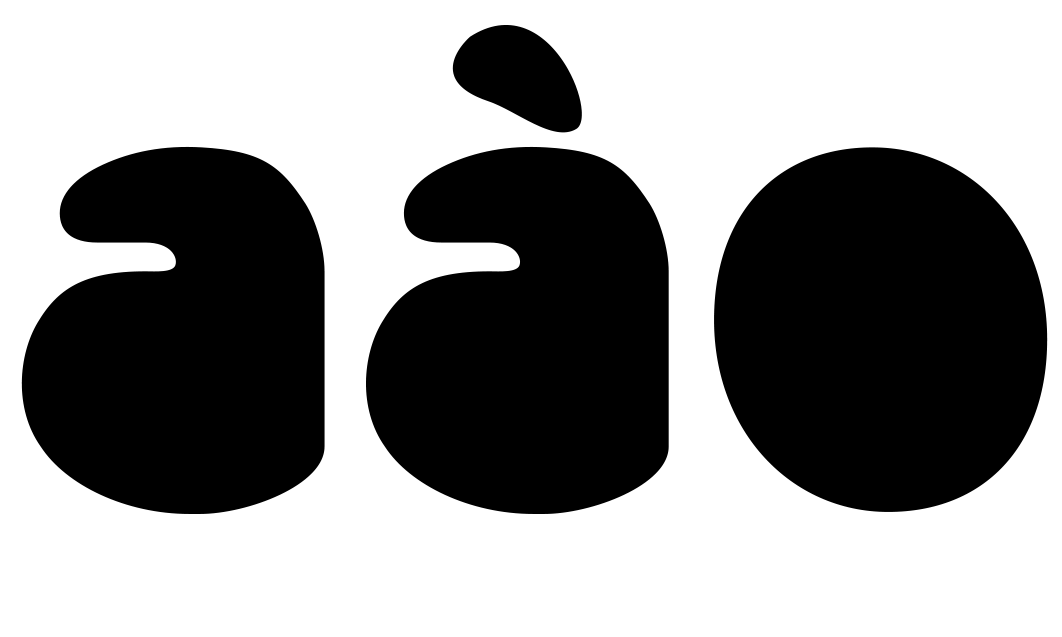Antoine d’Agata
Né à Marseille en 1961, Antoine d’Agata quitte la France à dix-sept ans pour rejoindre le monde de la nuit. Il vit et voyage à travers différents pays avant de rejoindre New York en 1991 où il découvre la photographie, notamment auprès de Nan Goldin et Larry Clark. Rompant avec les codes photographiques établis, il développe un langage singulier, une pratique autonome qui, sans cesse, questionne les fondements des langages documentaires et artistiques, une œuvre monstre mêlant photographie, texte et vidéo, qui se préoccupe avant tout de ceux qui vivent en marge de nos sociétés. Acteur d’un monde qu’il expérimente du côté des parias et des laissés pour compte, Antoine d’Agata cherche à sonder la réalité pour en dévoiler une vérité. Le corps, central, est politique, conditionné par des déterminismes sociétaux, culturels, économiques, et ne parvient à trouver d’exutoire et de transcendance qu’au travers des états limites atteints par la drogue, le sexe et la fréquentation de la mort. Alors, se dévoile comme un cri l’essence de notre humanité.
L’artiste, membre de l’agence Magnum, a couvert de nombreux conflits armés à travers le monde et est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages.
dispositifs
résidence au centre des demandeurs d’asile de saint-brévin-les-pins
& édition de l’ouvrage dispositifs en 2025 dans le cadre du festival cargo 2024
Nous remercions particulièrement la ville de Saint-Brévin, l'association Aurore et les travailleurs sociaux du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile (CADA)
« Chemins désolés, dérives aveugles, attente d’un hypothétique salut économique. Ils confrontent la peur et mettent leur désir à l'épreuve de tous les dangers parce que partir est la dernière stratégie possible et la survie, le seul enjeu à hauteur des risques encourus. Ils échappent au sort qui leur est fait par des logiques de marché omnipotentes. En marge des lois perpétrées par des autorités que désignent ceux qui, jaloux de leurs privilèges, se refusent à endosser toute part de responsabilité, sont soumis aux impératifs d'une gestion implacable des corps excédentaires. Leur existence est colonisée, niée, statistisée, rentabilisée et vaut moins, tout compte fait, que toute autre. Ils se cachent et crèvent de ne pas être vus. Irrémédiablement mis à l’écart, hors de portée de regard et d'acceptance de ceux qui se vautrent dans le confort de sentiments identitaires ou racistes, ils sont condamnés aux rites archaïques de la survie, au risque d'y laisser leur peau. Nous ne savons rien d’eux, parce que nous ne les voyons pas. La présence de toute chose étrangère, de toute altérité, de toute extériorité nous est devenue insupportable, bien qu'intangible, sinon aléatoire. Il est complexe – ou futile – de comptabiliser les morts anonymes enregistrées aux portes de la citadelle Europe, – corps dont il ne reste ni trace ni dépouille. La dimension héroïque de ces odyssées ne pouvant être signifiée par la récurrence et l’invisibilité – chaque jour réitérées –, de ces épisodes sans gloire. Reste à tenter de traduire la froideur des chiffres par des mots, et l'impuissance des mots par des images. Reste à rendre des comptes à une humanité meurtrie, bafouée par le silence des statistiques. Reste à affirmer la prédominance de l’humain sur l’économique. Reste à saisir, au-delà des affects et des passions, l’enjeu réel de processus contemporains de colonisation et d’exploitation dont les mouvements migratoires ne sont que les symptômes. Reste à vivre à hauteur des mots, à hauteur de mort. Eux meurent chaque jour dans des gares et des ports, des abris de fortunes ou des camps qui ne disent pas leur nom, sur des embarcations de misère et sous les bombardements. Aucune de ces morts n’est accidentelle. »